L’année commence comme une baignade de soleil et de lumière orange et jaune. Je regarde le soleil se lever sur cette mer qui m’a sauvé, celle que j’ai vu dans un rêve, lorsque je m’étouffais sous ma couette, la tête dans l’oreiller, quand je savais que j’allais devoir quitter ma vie, arracher le pansement rapidement avant de finir toute bleue, sans oxygène, morte derrière le rideau, sans savoir dans quelle eau me jeter - pour échapper à la noyade, j’ai plongé dans la mer.
J’ai parié sur mon endurance, j’ai prié pour avoir du souffle, j’ai appris à respirer entre deux chapitres.
La première image de mon année ressemble à une chorégraphie de la solitude.
“Dérive”, c’est dé-river, c’est quitter des rives.
Selima Karoui
L’exil comme déterritorialisation de soi
Je parcours un numéro de la Revue des littératures de langue française de automne 2013, Tunisie-diaspora : exils et dialogues, acheté la première semaine de mon arrivée à Tunis. Je bloque sur le texte de Selima Karoui.
Elle se (me) demande : où se place mon sentiment d’exil ?
C’est en écoutant parler Khémaïs Ben Lakhdar dans un épisode du podcast Couture Apparente réalisé par Claire Roussel1 que je commence à dessiner une boussole dans le sable : je ne voulais pas que la Tunisie devienne un fantasme, une idée, une histoire de clichés.
Alors que je commence à marcher vers mon identité tunisienne, qu’elle prend une place dans des discussions que je ne maitrise pas encore, que je cherche à comprendre l’origine de l’histoire, et incorporer au récit de nouvelles possibilités d’écrire, et de me décrire - d’envisager aussi tout ce qui me manque, et que je comble avec le peu d’outils à ma disposition, que je commence à comprendre de quel endroit je parle, un endroit dans lequel je trouve peu de récits qui me ressemble, que je doute en permanence - qu’au même moment je partage ma vie avec une personne qui me dit ce que je peux être et ce que je dois être - je questionne l’histoire qui m’a été racontée.
Parce que l’on se bat pour les histoires auxquelles on croit.
J’ai fais de la question comment raconte t’on les histoires un des fil rouges de mon existence. À l’université je travaillais les questions de narratologie, puis j’ai commencé à vraiment politiser cette question dans mon esprit. Une rengaine obsédante : qui raconte l’histoire ? pour qui ?
Je ne savais pas encore qu’avait commencé une traversée vers ma propre histoire. Celle de la petite fille à l’identité comme un sachet de purée lyophilisé.
Aux confins de l'identité #3
Cela fait une semaine que je suis prisonnière d’un état blanc, enveloppée d’impossible repos, mes idées sont comme coincées dans un barrage, je suis trop fatiguée pour sortir, me perdre dans la nouveauté - je suis même impuissante face à ce sac de chagrin qui grandit dans ma poitrine et que je suis incapable de pleurer. Tout est barré. Déviation.
Aujourd’hui cette question est omniprésente, on entend résonner les petites musiques, les ritournelles, qui furent plus lointaines mais jamais murmurées, celles de la domination et du désir de possession. De l’effacement, de la supériorité fantasmée.
Je me réveille encore parfois avec les yeux de cet homme qui me fixe - au fond de sa rétine c’est tout un monde que j’ai aperçu - et son visage de pierre, son visage dans lequel aucune vie n’est possible, sur lequel se lit une histoire que se racontent les suprémacistes blancs, une histoire qui dit la peur.
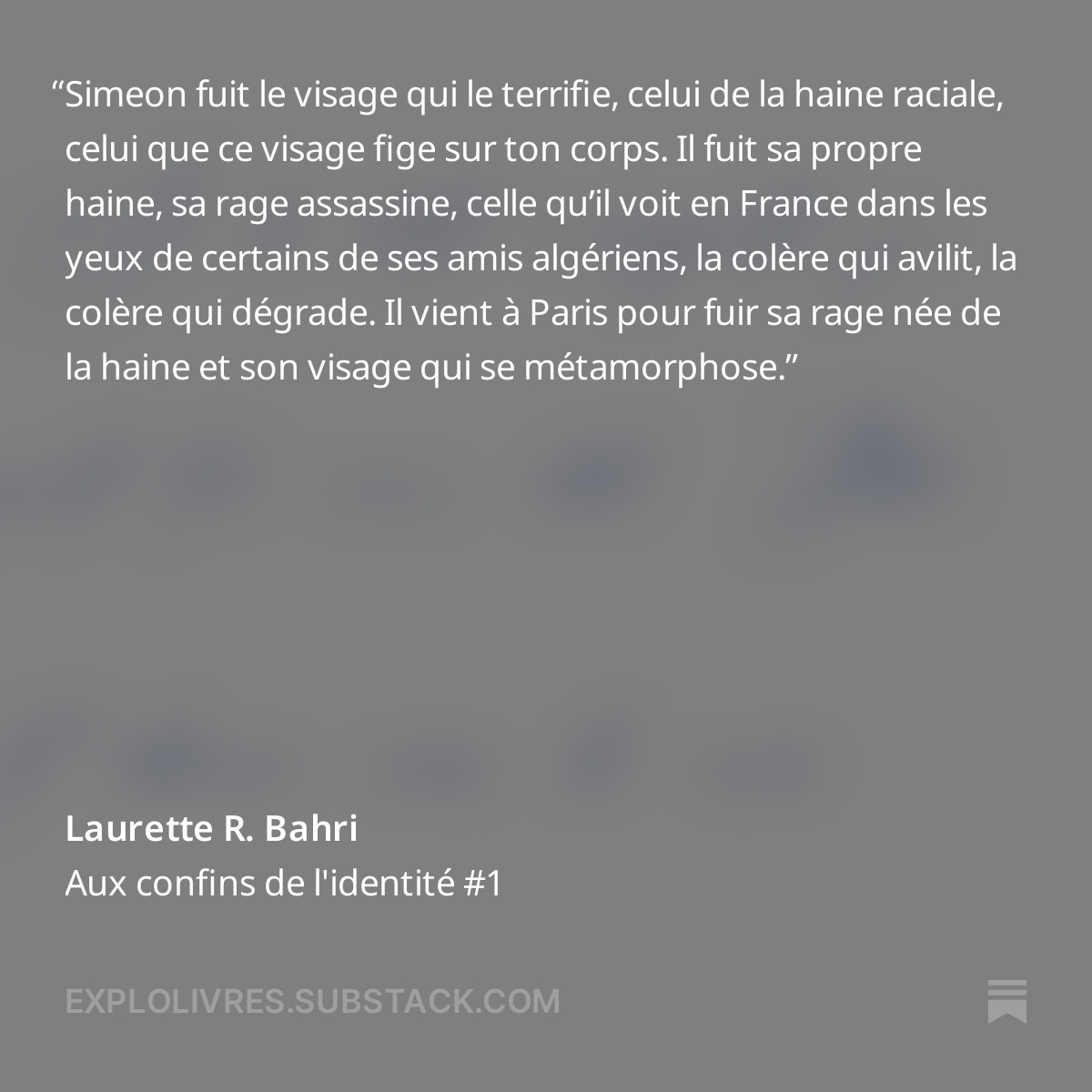
Les histoires ne sont pas juste des petites choses du soir. Un petit plaisir comme des hlou. Elle définissent les contours de ce en quoi nous pouvons croire.
If this is your land, tell me your stories
Refaat Alareer
Je découvre l’histoire confisquée, celle dont j’ai été privée et que j’ai vécu pendant des années comme la raison principale de ma perte de la Tunisie. Elle n’existait dans aucun souvenir, nous ne partagions ni passé, ni présent, ni futur. Amputée de toute une bibliothèque, j’ai fini par l’oublier. Même les plus petites choses, même les clichés, même les motifs les plus orientalistes et puis arriva un moment où les grandes choses disparurent : un père à attendre, des grand-parents à connaître, une langue à parler et une terre.
À quoi ressemblent les fondations d’une maison construite avec une moitié manquante, du bois humide, du ciment sans sable, de la terre mal cuite - à quoi ressemble une part manquante, comme un membre fantôme, qui fait mal sans qu’elle n’existe nul part.
Quoi devenir lorsqu’on a été amputée d’une histoire. Non pas que partielle mais partiale, une histoire qui en juge une autre, qui lui confisque toute une rangée de possibilités, qui salit sa mémoire. Qui use le sel des marais pour punir le sol et que rien n’y pousse.
Dans les histoires que l’on me racontait, mon père était un danger potentiel, on me l’a présenté comme un étranger, un ailleurs, une forme abstraite - rien n’indiquait qu’on le voyait chez moi. Je ne sais absolument rien de lui ; pas une anecdote ni une chanson qu’il aimait - je n’ai eu que les bribes, des constructions mentales orientalistes, quelques gouttes de fleur d’oranger, un voyage dans un hôtel à Hammamet, des roses des sables.
On m’attribuera un plat préféré, un couscous préparé sans épices - me répétera autant de fois que nécessaire à quel point je suis pâle, à quel point j’ai mauvaise mine, à quel point je suis blanche.
Je me suis tenue à l’écart de la Tunisie par peur de la fétichiser. Qu’elle me rejette, qu’elle ne me reconnaisse pas.
Mais aussi, de ne pas réussir à la comprendre, à l’habiter.
Je découvre la nostalgie à rebours.
Dans “Stories make us” le professeur et poète palestinien Refaat Alareer, assassiné par l’armée israélienne le 6 décembre 2024, rappelle l’importance des histoires et de la transmission orale : faire appartenir la mémoire et entretenir un lien avec les racines, les faire pousser dans le corps qui garde le souvenir de ce qui a existé et continuera d’exister à travers elles.
S’il est écrit que je dois mourir
Il vous appartiendra alors de vivre
Pour raconter mon histoire
Pour vendre ces choses qui m’appartiennent
Et acheter une toile et des ficelles
Faites en sorte qu’elle soit bien blanche
Avec une longue traîne
Afin qu’un enfant quelque part à Gaza
Fixant le paradis dans les yeux
Dans l’attente de son père
Parti subitement
Sans avoir fait d’adieux
À personne
Pas même à sa chair
Pas même à son âme
Pour qu’un enfant quelque part à Gaza
Puisse voir ce cerf-volant
Mon cerf-volant à moi
Que vous aurez façonné
Qui volera là-haut
Bien haut
Et que l’enfant puisse un instant penser
Qu’il s’agit là d’un ange
Revenu lui apporter de l’amourS‘il était écrit que je dois mourir
Alors que ma mort apporte l’espoir
Que ma mort devienne une histoireRefaat Alareer - S’il est écrit que je dois mourir
traduction : Nada Yafi2
Le pouvoir du narratif, des fictions que l’on raconte et que l’on se raconte est au coeur du combat contre le fascisme, celui qui conquit et détruit partout en Occident, des États-Unis à Israël en passant par la France, traversé par la même idée : celle du droit à l’extermination des uns par les autres.
« Il y va, en somme, de la force rétrograde du vrai qui construit l’histoire via l’écriture qu’on en fait, history et story, comme un performatif du passé ; car les historiens font exister un certain passé quand ils écrivent l’histoire, à partir de leur connaissance du présent, selon leur perspective et leur visée . »3
Je suis en train de découvrir la profondeur de ce que le mot racine veut dire.
C’est au creux de ce mot que j’ai commencé à changer de l’intérieur et raturer les définitions apprises par coeur.
Il y a un an j’écrivais “Lettres tunisiennes à l’eau salée”, c’était les prémisses - je balbutiais ce qu’aujourd’hui je n’ai même plus besoin d’affirmer, ma tunisianité, si je devais résumer l’année passée, je dirais qu’il y eu deux temps : celui de l’affirmation par une identité politique et celui de la découverte de la nostalgie et une expérience organique du retour en pays d’origine.
Je distingue plutôt trois temporalités et deux espaces.
Dans un premier temps, je me suis éloignée de ma blanchité (dont je porterais toujours une part en moi), dans un contexte français, qui force chaque identité à être automatiquement politisée et qui organise certaines dynamiques intra-communautaires et inter-communautaires.
Ce que ne disent pas des termes comme racisé.es ou white passing c’est tout ce qui nous connecte, comme le deuil collectif, que ces plaies béantes que seules les prières peuvent ramener à l’espoir soient du fait de l’ingérence coloniale et occidentale, que les armes logent dans les mains de policiers français ou de soldats israéliens, de diplomates européens ou de présidents américain, nous partageons une souffrance commune, quelle que soit la forme que nous lui faisons prendre ensuite.
M’éloigner de ma (la) blanchité a eu pour effet de m’éloigner d’une énorme partie du monde qui me constituait, parfois sous forme de personnes, de proches aujourd’hui lointains, et des histoires qui me furent racontées. Contrairement à d’autres personnes qui grandirent dans leurs familles, avec un accès plus ou moins affirmé à la transmission (langue, culture, coutume, histoire), qui construit un rapport aux identités du Maghreb avec ses particularités4, j’ai été élevée dans le mythe du pays des droits de l’homme le plus idéalisé, une famille athée qui aura pourtant intégré sa dose de catholicisme dont un racisme décomplexé sous couvert de bonnes oeuvres et un goût pour la laïcité, confondue avec l’islamophobie.
Certaines croyances viennent tout droit des colons
Tu peux faire le tri pour t'rapprocher de Dieu
Youssoupha - Dieu est grande
J’ai alors désappris une histoire, l’ai annoté de stylo rouge, et je commence à en apprendre une nouvelle. Je veux la comprendre pour ne pas tomber dans l’idéalisation ou l’essentialisation.
Après une période de sas, de juillet à septembre, au cours de laquelle, j’ai, je crois, lutté contre toutes mes contradictions. La plus évidente étant confrontée dans ma relation amoureuse d’alors, j’ai resserré mes liens avec l’écriture jusqu’à me rendre aveugle au reste, jusqu’à ne plus voir l’état anxieux permanent dans lequel j’étais plongée.Puis j’ai décidé d’écouter les signes : ceux qui me guidaient vers la Tunisie, et le retour ; dans un second temps, dans un temps toujours au présent, j’ai commencé à me désaxer de l’Occident.
Je commence à comprendre ce qu’auparavant je percevais en théorie. Je dois apprendre à accepter que je n’ai pas encore tout les mots, ceux qui peuvent aussi parfois aider à mettre une certaine distance émotionnelle - depuis que je suis arrivée à Tunis, tout n’est que destin du corps et souffle dans l’âme.
Là où jusqu’ici j’avais besoin de théorie pour expliquer mon ressenti, le courant change de sens et je navigue à vue, à l’instinct, je me laisse être guidée par les sensations et les découvertes par l’expérience.
Quelque chose est en cours de métamorphose, je suis encore dans un nuage épais, cette étape intermédiaire, dans laquelle peut-être que je resterais. Une évolution qui change le regard - un décalage de perspective.5
Se savoir et se sentir être étranger à une partie de soi tout en se sachant Autre : c’est le sentiment à partir duquel Edward Saïd développera toute sa pensée critique, en tant qu’américain et en tant que palestinien, qui a grandi en Egypte sans être égyptien, avant de rejoindre New-York à l’adolescence. Il raconte dans son autobiographie, “Out of place” comment il s’est reconstitué tout un imaginaire, à partir de l’apprentissage (du ré-apprentissage) de la langue arabe, il s’est ouvert les portes du savoir oriental, lui tout aussi imprégné de la culture occidentale, de tradition anglocentrique selon ses propres mots.
C’est à partir de lui, et de sa propre métamorphose qu’il écrira son ouvrage le plus connu : L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident en 1978.
Sa pensée est l’observation de cette mue.
muer : verbe transitif du latin mutare, changer.
Sens littéraire : transformer quelque chose en autre chose
Larousse
J’ai envié celles et ceux qui connaissaient la Tunisie, qui rentraient l’été, qui se sentaient légitimes à parler de la fierté des nôtres. Je les ai regardé comme une petite soeur regarde ses aînés. J’ai écouté leurs histoires, j’ai plié ma propre feuille pour voir où nos coins se rejoignaient.
Je vous racontais dans Aux confins de l’identité, le rôle de Barbès blues de Hajer Ben Boubaker et de ma dernière promenade dans Paris, mes adieux à l’entre-deux, un pont, une transition vers l’histoire que j’allais commencé à écrire une fois mon nom posé sur le tarmac, mon nom de naissance qui en cachait un autre Bahri.
Ce n’est pas que l’héritage d’une histoire de combats politiques qui m’a mené ici, c’est aussi une fierté et l’intuition d’un vide à combler.
J’ai passé un an à regarder des réels sur Instagram pour calmer mon anxiété, des photos de la Tunisie qui me donnaient envie de pleurer sans que je ne comprenne pourquoi, écouter des chansons en arabe sans distinguer les mots des autres, et au plus effrayant de la fuite, lorsque brûlait mon estomac tordu par la peur, je m’imaginais sur l’autre rive, je tremblais d’impatience, je savais que j’avais déjà préparé le voyage.
Ce qui rapproche Ulysse et Edward Saïd, deux out of place, exilés nostalgiques. C’est l’impossible retour et le combat pour tout ce en quoi ils croient.
La nostalgie est aussi un moyen de faire exister des territoires.
De préparer le retour.
C’est lorsque le devin chante Ulysse et son moment de gloire à Troie, qu’il redevient “fils de Laërte”, ayant tout perdu jusqu’à son nom et son humanité - aux portes de l’immortalité avec Calypso puis héros qui entre dans les mémoires - il devient une histoire - il peut alors reprendre le chemin d’Ithaque. Bien qu’il porte en lui cette dualité : “garder Ithaque en son coeur, mais aussi veiller à ne pas perdre la vision de ses errances” (Günther Anders), ne pas oublier sa patrie et ne pas oublier son désir d’aller ailleurs.
Autre décalage, le temps de la nostalgie est grammatical, il a une conjugaison, c’est le futur antérieur, un « il aura été », comme tout récit des origines. Où l’on découvre ici en effet que le mot même de nostalgie, de nostos, le retour, et algos, la douleur, douleur du retour donc, n’est pas un mot grec, on ne le trouve pas dans l’Odyssée, mais un mot suisse allemand, nom d’une maladie répertoriée comme telle au xviie siècle par un médecin (Jean-Jacques Harder), pour dire le mal du pays Heimweh, dont souffrent les mercenaires suisses de Louis XIV, ou mot inventé en 1688 par Johans ou Jean Hofer dont la thèse de médecine à l’université de Bâle décrit des cas de guérison miraculeuse par le retour.6
En allemand, unheimlich c’est l’inquiétante étrangeté de Freud.
Chez Saïd aussi on parle de la maladie de la nostalgie : on la soigne par les goûts, les odeurs, les histoires.7
“retour en pays d’origine” , j’avais initialement écrit “retour en pays natal”
« La concurrence des amours, le rapport entre le nouveau et l’ancien, la manière dont le nouveau devient ancien et l’élan habitude, bref le temps comme ligne et cycle, sont l’une des clefs de la nostalgie »
Barbara Cassin8
Si mon histoire avec la Tunisie a commencé à s’écrire dans la souffrance, le manque puis l’attente qui mena à l’oubli, qui est une forme de rejet puis une odyssée longue de plusieurs années, un long retour avec sur le chemin la disparition d’un nom - c’est aujourd’hui que je la comprends vraiment, dans l’écriture de notre histoire avec le corps. Je l’expérimente organiquement.
J’éprouve la reconnaissance.
Elle passe par le unheimlich, tout est étrangement familier, malgré la barrière de la langue.
C’est comme si mon sang commençait à se réchauffer et à mieux circuler, je me reconnais dans le miroir là où j’avais la sensation de disparaitre pendant des années. Je découvre le terme appétit, je ne mange pas uniquement parce que la culture de la nourriture est d’un tout autre niveau ici, mais j’ai faim, et j’ai soif comme si tout avait eu un goût de cendre pendant trente ans. Je suis une statue qui prend vie. Certaines odeurs me rendent émotive, je garde une orange sur mon bureau pour m’aider à écrire - mon parfum a changé, mes cheveux lustrés d’huile d’argan, ma peau qui reprend ses couleurs d’origine, celle de mes photos d’avant tout ce qu’on aura essayé de supprimer chez moi.
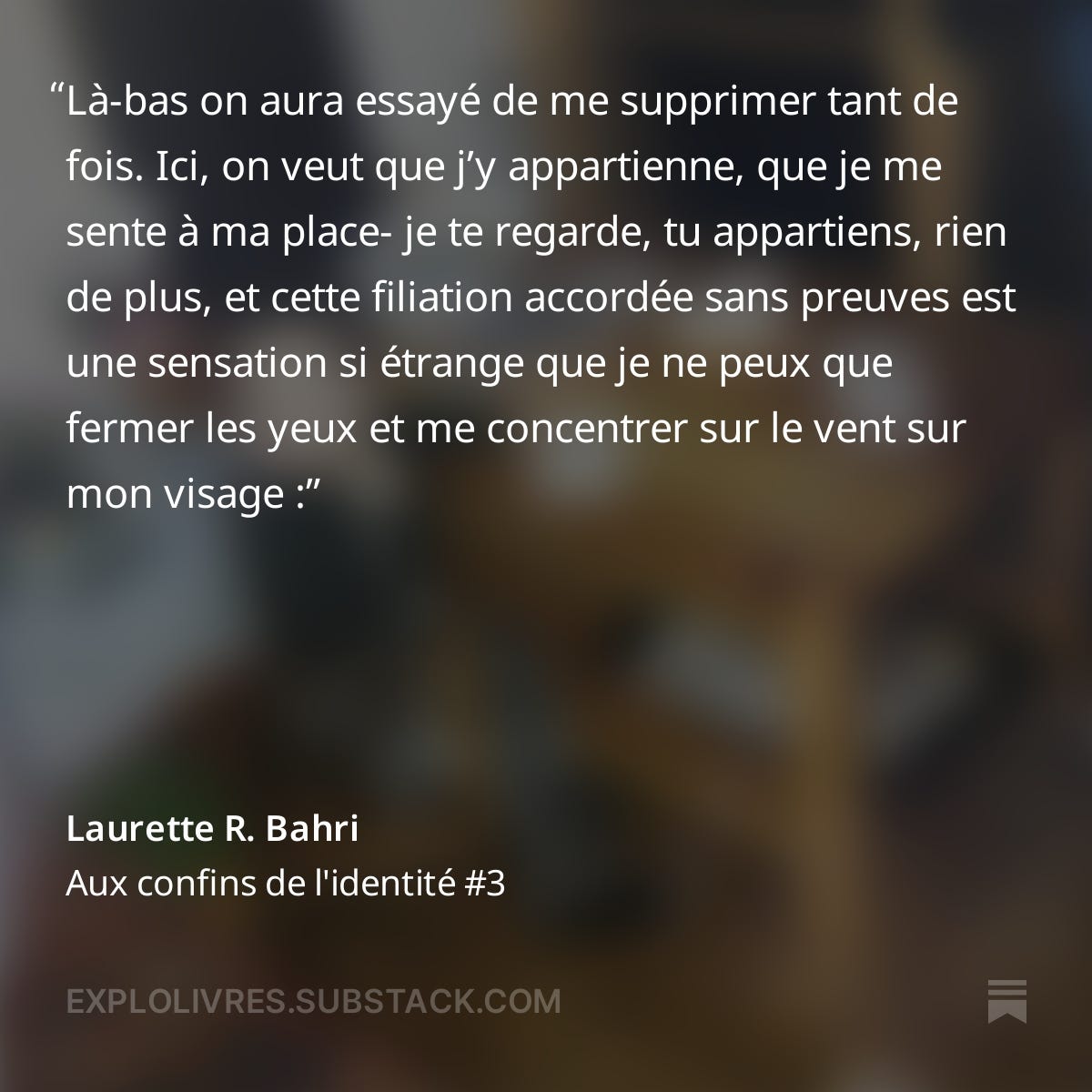
Je lis sur la nostalgie et je me sens moins seule, je ressens que je sors de la racine théorique, que je deviens un tronc organique.
“Deux leçons complémentaires :
pas d’appréhension de l’altérité sans rapport à l’identique, et pas de certitude de l’ailleurs sans conscience de cette perte qui produit l’assimilation .”9
Petit à petit je cartographie mes déplacements intérieurs, j’accumule de nouveaux thèmes, je me sens aussi submergée que comblée que seule, je vis une transition non pas que de moi à l’extérieur mais je deviens ma propre altérité.
C’est un gigantesque raz-de-marée, entre ce que je crois, ce que je croyais, ce que je croyais savoir, ce que je pense, ce que je pensais, ce que je croyais penser, mes références, mes regards, mes points de vue, celui des autres sur moi, ceux du passé, ceux du présent, ceux d’ici qui voient en moi ce qu’on a toujours refusé de voir, le là-bas, le ici et moi chaque jour devant le paysage qui change.
Mon nom et mon visage comme seuls repères pour retrouver le mien.
Je n’ai jamais autant accepté d’être observée qu’ici. On voit dans mes yeux, mes origines certaines, on cherche les régions possibles de mon enfance, Tunis, Gabès, Beja. Chaque fois que l’on me dit bienvenue à la maison, bon retour, el Bahri, Bahrouna, you have a tunisian soul, sourire, regard -que l’on me demande si je suis tunisienne - c’est mon histoire au présent que je peux raconter, mon kaïros.
Quitter mon corps auquel je suis rivée, c’est m’exiler. Rompre avec mon corps dans son relâchement avec l’esprit. Rompre avec mon origine, et retrouver l’origine, la vraie.
Selima Karoui10
Retrouver l’origine derrière la porte bleue.
L’opportunité à saisir, le kaïros, le mektoub.
You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I'll rise.Maya Angelou - Still I rise
Je rejoins la mer qui pleure de me voir revenir, comme ces grand-mères à l’aéroport, derrière les portes, qui attendent que la joie envahisse leurs vertèbres, jusqu’au frisson de plus, celui qui déclenche le sourire.Je rejoins la mer après avoir versé toutes mes larmes dans le hall de l’immeuble de cette vie que je pensais vouloir vivre, que je pensais être la destination que j’attendais, celle d’avoir un foyer, et un cœur à protéger.Je viens plonger mon cœur meurtri par les années à essayer d’être aimée, à penser l’être mais toujours sous certaines conditions impossibles à remplir sans faire de mon corps un chewing-gum qui aurait été trop mâché.J’attend de me faire au bruit des vagues avant de m’y glisser, je suis ici comme une étrangère familière qui doit réapprendre à redresser la colonne - j’attend que les cicatrices se referment, un peu, pour ne pas être saisie par le sel et devenir statue.Je clôture l’année en faisant les comptes. Pour l’année qui commence je laisse tout ce qui m’a couté, il n’y a plus rien à sacrifier ; je regarde vers tout ce que je gagne. Le temps des soustractions est terminé.
Avec lui, celui des regrets.
Devant moi, une maison, la mer bahri la mienne, les prières.
Je vais bien
Al-Hamdoulillah
S’abonner à la version payante de DERRIÈRE LE RIDEAU BLEU est ce qui me permet de continuer à gagner en indépendance créative. Si vous aimez mon travail, vous pouvez également partager à vos proches et gagner des mois gratuits.
Chaque abonnement vous donne accès aux textes précédents.
Je souhaite garder un équilibre entre rémunération/valorisation de mon travail et partage de ressources gratuites, alors si un sujet que j’aborde dans un texte payant vous touche particulièrement mais que nous n’avez pas les moyens financiers ou autre, sans justification, envoyez-moi un mail.
La Pleine lune du 13 janvier me promet (soleil en Cancer) des gains inattendus, ne faites pas mentir l’astrologie ♋
l’incroyable Claire Roussel, si vous vous intéressez à la mode éthique, il faut suivre son travail ici
Barbara Cassin, La nostalgie : quand donc est-on chez soi ? Ulysse, Énée, Arendt, Paris, Éditions Autrement, coll. « Les Grands Mots », 2013.
sur cette question, voir le magnifique documentaire “Leur Algérie” de Lina Soualem
émission “Avoir raison avec… Edward Saïd”, épisode avec l’historienne Leyla Dakhli
Barbara Cassin, La nostalgie : quand donc est-on chez soi ? Ulysse, Énée, Arendt, Paris, Éditions Autrement, coll. « Les Grands Mots », 2013.
ibid
in “L’exil comme déterritorialisation de soi”, Tunisie-diaspora : exils et dialogues



















C’est sublime, quel beau retour à toi 🩵